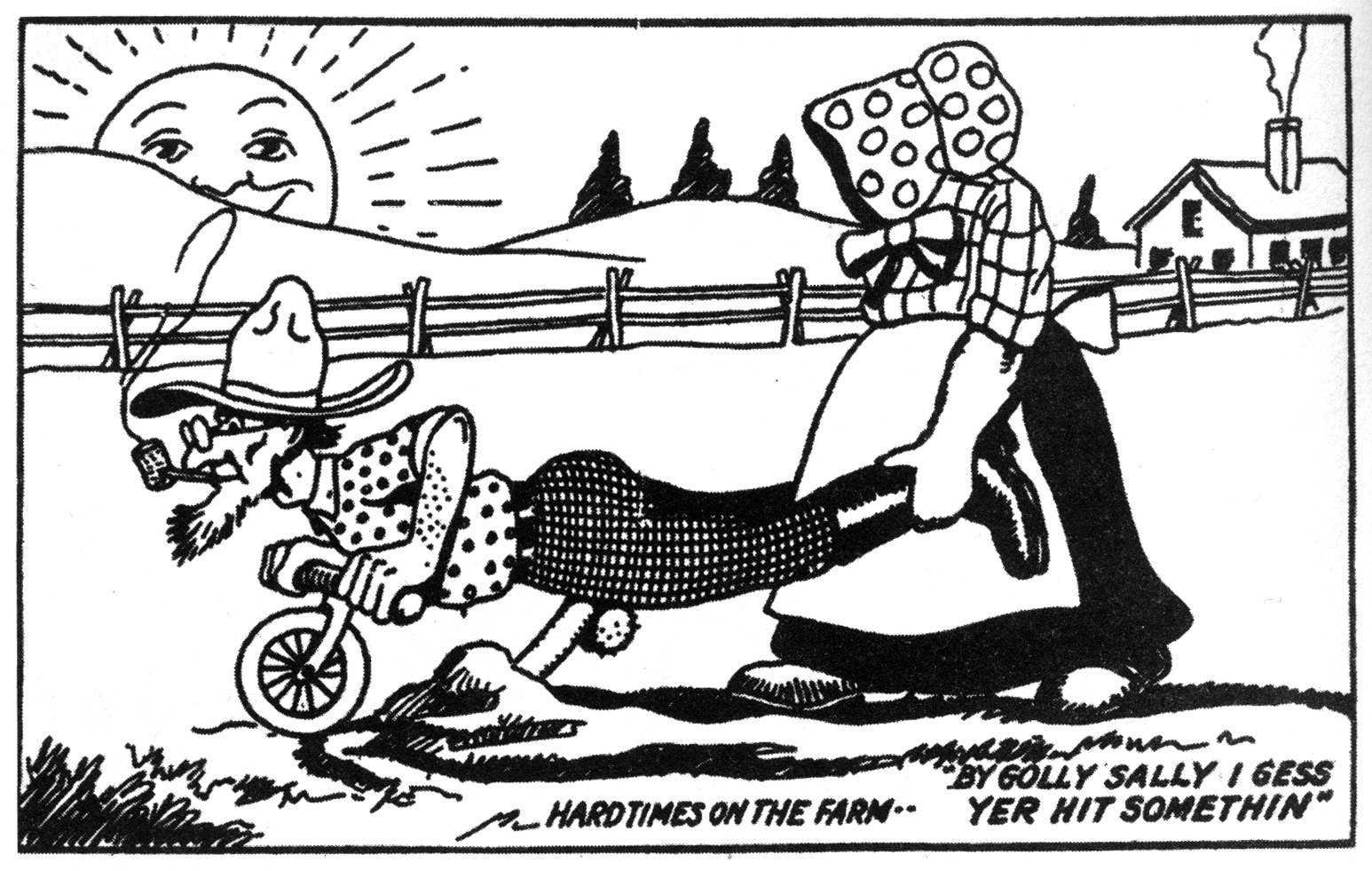Agir en ne faisant voluptueusement rien, règle du jeu
Lors des “encieros” de Saint-Rémy de Provence dans les années 80, les plus jeunes, les «attrapaïres» couraient derrière le taureau à la corde pour tenter de l’immobiliser. D’autres habitants du village, plus madrés et de conditions sociales très diverses, agglutinés sur un massif de fleurs au milieu du carrefour de l’église, faisaient les “statues”. Les bêtes étaient censées nous confondre avec le décor et nous ignorer. Il arrivait que le toro se cale en fulminant face au groupe pour en tester la fixité… L’art de faire l’arbre mort se transformait alors en bravade initiatique. L’immobilité sans faille du bloc improvisé assurait sans doute sa survie, mais le moindre geste incontrôlé d’un élément pris de panique conduisait assurément à la folle débandade….
José Bergamin cite le cas de ce Tancredo Lopez qui fût le maître de la statuaire dans l’arène au début du XXeme siècle. Vêtu de blanc, juché sur un cube, il défiait le taureau dans une parfaite immobilité
. « … ainsi devient-il une incarnation visible et transcendante de la totalité de notre être, face à la vie, grâce à la mort, face à l’éternité du probable … Don Tancredo n’est rien d’autre qu’un homme seul, non pas vide, mais pleinement seul, face à la mort, et en définitive, devant dieu … autrement dit, le paradoxe d’avoir trouvé le secret du courage apparent dans l’immobilité même de la grande peur, celle qui paralyse d’effroi, celle qui laisse la femme de Loth, terrorisée, changée en statue .. »
Le stoïcisme Tancrediste, forme de quiétisme en quelque sorte, une utopie dans laquelle les acteurs se confondent innocemment avec le décor.
Si les virus avaient seulement l’intelligence d’une vachette camarguaise, ils seraient leurrés par le confinement.
JMP/2020
Tranche de vie graffiti en 328 mots / 1970-2021
“Je suis le Chat qui s’en va tout seul et tous lieux se valent pour moi” proclame le matou de R.Kipling dans un livre pour les enfants. Ce “ready-made-cat of constant sorrow” m’invita à sa suite.
Projet concret. Savoir faire de tout un peu pour se dégager des dépendances. Alors, j’ai observé ardemment les gestes décisifs. Forgeron pour tordre le fer, maçon tailleur de pierres, garagiste rodeur de soupapes, projectionniste rembobineur de films, toubib mouleur de plâtres. Et la soudure, la machine à coudre, la grammaire avec un grand père, l’art de dépecer les lapins avec l’autre. Plus tard, coup de foudre avec l’électricité, la linguistique, le matérialisme historique et le braconnage.
En conséquence, dans les années 70, nous fûmes des « Robinsons » modernes à la sédentarité nomade, vivant à la lisière des villes et des villages, autarciques, à l’abri de toute consommation superflue, aimant, buvant et ripaillant comme des princes sans le moindre souci pour la fébrilité des planètes. Le terrain de jeu était vaste, le monde en l’occurrence, assez grand pour nourrir gratuitement ses enfants rebelles. A cette jubilation éclectique cependant, il manquait un arc.
Katja B., belle amie chorégraphe, m’enseigna alors en quelques nuits la mathématique musique des temps. Du coup, mesure pour mesure, je devins architecte de la détermination à rester indéterminé. La fête pyrotechnique en fut la fin et le moyen. Le sortilège du conte synthétisa tout ce qui constituait alors nos âmes romantiques en le consumant: Artaud, Beckett, Lennon, Victor Hugo, le fer à souder, le canon à image, le rouleau de scotch et la pince coupante, John Cage, Verdi, Kate Bush, la machine de tir, l’a-peinture de l’espace, Rimbaud et les trames de ponctuation …
A la fin de tout, mission accomplie, potlatch exténué, du feu de l’art ne subsisteront que cendres et poussière.
La semence lente d’une comète métaphorique,
l’apesanteur échevelée du noir.
Dans l’intervalle, restes, ratures, photos bougées, compagnies célestes.
Sinon,
belle dérive souveraine, plus d’un million d’années durant, environ…
1970-2021/JMP
Spéculations sur le calcul de l’avance à l’allumage
« si je connaissais ma force centrifuge, je casserais tout! » Josef Morel, bar des Alpilles, 1983.
Dans le mouvant, l’anticipation est partout. On apprend cela en réglant le moteur des motocyclettes japonaises. Trop d’avance, on ne démarre pas. Pas assez d’avance, et l’explosion fait long feu, lèche le piston et le perce. Pourtant, à l’oreille, ça tournait rond. Mais les moteurs à explosion, c’est à la fois rond et carré, et passons sur la richesse du mélange.
Le mouvement alternatif, lié à un déplacement régulier, engage des inerties contrariées qu’on s’évertue à lisser au mieux.
J’observe le vol des oiseaux migrateurs. Chacun son tire d’aile, pour former le V caractéristique de la course en peloton. Deux formations se croisent pour ne former qu’un seul profil, et puis se re-divisent. Le sentiment chorégraphique domine à nos yeux. Lequel à commencé, qui orchestre? Une foule de gens ne pourrait se comporter ainsi sans un tenseur global superposé au contrôle local des distances interindividuelles. L’oiseau, de son point de vue, en tire peut-être les mêmes conclusions.
Je postule que cette cinétique figurative est une synthèse harmonique du poids des mots multiplié par la vitesse du battement de cils et je pose:
Energie du message = Masse des mots x (Vitesse du message)2 .
Pour une énergie donnée supportable, plus la vitesse sera grande, plus la tonalité et le poids des mots tendra vers zéro.
Communément, entre prédateurs et prédatés, l’instinct de fuite a qualité d’arc réflexe. A contrario, la réflexion est un temps mort, le temps de la conscience, dit Sartre. Platon aurait en sus contesté l’usage d’un babil empressé quand il est employé aux fins d’ensorceler l’auditeur !
Corollaire spatio-temporelle:
De nos jours, quand la vitesse absolue de l’information dépasse le message, cette célérité peut conférer au pire délateur refoulé un misérable statut d’écrivain ! Peu importe le contenu crapuleux, il en est ainsi depuis des siècles. La démagogie hargneuse polluait déjà l’agora chez les Grecs.
Quand l’émetteur se confond avec son propre récepteur, il y a court-circuit.
Quand la parole est réduite à la communication du message, le langage devient un code machine.
Stricte machine à paraphraser le prévisible.
Délivrant non plus des informations, mais des ordres.
Et l’image se répliquant, l’épidémie se propage en fac-similés dérisoires d’un proto-vide réduit à son reflet réverbéré à l’infini.
Conjecture socio-dramatique:
Figée dans cet éblouissement temporel entre œil et oreille, toute communauté sociale se délite et puis se recombine en meutes unicellulaires primitives. Cette instantanéité aliénée rend alors obsolète la syntaxe démocratique colportée à dos d’homme. D’une manière pernicieuse, masquée, l’algorithme des moteurs de recherche, en visant à cerner uniquement ce qu’il ordonne en profil, anéantit toute contradiction. C’est le principe du fanatisme, du prosélytisme, de l’auto-conviction hystérisée sur fond de consanguinité.
« L’être générique objectif » de Marx a bon dos.
Ainsi voit-on la proie sur le champ prendre la pose, portée au tombeau par son ombre, morte-vivante.
Catabolisme convulsif de la Créature, étrange cortège tournant parfois lentement sans fin autour des giratoires.
Le rêve de Frankenstein, foirade pour une épidémie du consenti, avant-projet de film rétroactif.
JMP 20/1/2021
Compagnies & compañeros
sic transit gloria mundi
Ainsi passe la gloire du monde.
Le Living Théâtre à Avignon, mai-juillet 1968
Lorsque le Living Théâtre est arrivé début Mai à Avignon dans leurs minibus Combi VW, venant de Cefalù, petite île de Sicile, le mistral soufflait au delà du raisonnable. Jean-Marie Lamblard connaissait déjà quelques membres de la troupe. Jean-Marie est un de ces êtres que les histoires oublient et sans qui rien ne serait possible. Les passeurs, les connecteurs désintéressés, les princes de l’hospitalité. Il nous réquisitionna avec Christian Bourgeois pour aider à installer cette tribu nomade dans ce que nous appelons maintenant un squat : un ancien lycée vide et délabré mis à leur disposition par la mairie, là où se trouve l’actuelle médiathèque. Avec trois bouts de tissu et de bois, chacun pût construire son nid et l’ensemble final oscillait entre cabanes dans les arbres, temples Indiens et architectures d’Escher. Nous partagions les repas et de mémorables calumets de la paix préparés par Luke sanctionnaient nos efforts.
Une large scène avait été montée dans l’ancienne cour de récréation pour les répétitions. Dans ce pays de grandes bourrasques, les enfants jouaient là à poursuivre les feuilles, les mères droites immobiles, face au vent comme les chevaux en liberté, toutes voiles dehors. La vie se tissait dans le théâtre ou inversement. J’étais jeune photographe à l’époque. On est resté là des heures à se regarder vivre, sans autres questions. Je tirais une douzaine de photos la nuit pour les vendre le lendemain sur le trottoir de la rue de la République, et j’ai pu ainsi acheter mon premier Nikon. J’ai perdu presque tous les négatifs, mais j’ai retrouvé bien plus tard quelques photos jaunies chez des amis.
Je m’interrogeais sur la répartition des rôles entre Judith Malina et Julian Beck. Qui était le poète, le dramaturge, le graphiste, l’alchimiste, l’idéologue libertaire, le fournisseur de mythes dans l’histoire? Une catalyse de groupe? Il y avait un champ gravitationnel invisible qui liait cette troupe-laboratoire hétérogène, et elle ne dissimulait rien de ses composantes.
Chez Benedetto, on fonctionnait un peu de la sorte, mais sans témoins…Des discussions inépuisables, et puis on bricolait un truc scénographique à tester le soir, quand ceux qui avaient un “vrai” boulot venaient répéter.
Au Living, je cherchais à comprendre comment des affinités baroques produisent du sens et des figures. Ceux du texte ou de la dramaturgie, les constructeurs comme Luke, les peintres, les méditatifs, les corporels et les gambergeurs comme Echnaton, Steve, Julian. Il y avait aussi Jenny, sublime oiseau carbonisé….Tout cela dans l’ombrage de Brecht, d’Artaud et de Bakounine, la synthèse de Marx et Freud. L’accomplissement de Rimbaud ou Dada en actes. Ce théâtre résonnait alors des préoccupations du monde et de l’époque et subissait aussi son manichéisme bipolaire, théâtre bourgeois / théâtre populaire. Mais le théâtre est une molécule organique virale, elle échappe in fine à toutes ces réductions.
J’ai découvert la troupe à Bordeaux en novembre 1967, à Sigma III. Jean-Marie nous avait fait un récit quasi initiatique inspiré par la révélation absolue que fût pour lui le Frankenstein donné à Cassis en 1966, la pleine lune venant ponctuer l’expériment. J’étais donc aux aguets.
Le 17/11, La Passion selon Sade de et avec Sylvano Bussotti, Cathy Berberian et musiciens fut interrompue manu militari par des agitateurs violents d’extrême droite avec des pétards. Le living intervenait dans une espèce de figuration en fond et bord de scène avec des actes immobiles qu’on retrouvera ensuite dans Paradise Now. Quand la tension fût à son comble, il y eût un moment extraordinaire. Une partie de la troupe qui ne jouait pas se mit à traverser la salle dans tous les sens en surjouant l’apocalypse, agonisant au milieu des spectateurs, pendant que les autres, sur scène, improvisant une espèce de sit-in non violent , demeuraient impavides et vulnérables, les yeux perdus sur la ligne d’horizon. Ayant largement dépassé les espérances des agitateurs, ceux ci se trouvèrent fort démunis et le soufflet retomba comme un brouillard. Cette technique qu’ils possédaient avait été développée pour « Mysteries » et « Frankenstein ». Maintenant, avec des kalachnikovs, ça ne marcherait pas aussi bien.
Le lendemain, 18/11, même lieu, un Mysteries and Small Pieces savamment tempéré.
Le Frankenstein était prévu à l’Alhambra le 21, un grand théâtre ou avaient lieu coté salle les concerts de musique contemporaine, le ring de Pierre Henry, des matelas pour les spectateurs, les magnétophones de K.H. Stockhausen, et au fond coté scène, intrigante, la structure métallique à trois niveaux du Frankenstein, telle un sombre retable païen, en attente. Ces structures d’acier de l’époque étaient en tubes « Mills » très lourds, coupants, les mêmes que ceux utilisés dans le bâtiment pour les échafaudages.
Devant rentrer à Paris, je ne pus assister à la représentation, mais entre les récits, les traces, la présence des acteurs, je me suis arrangé d’une version rêvée sublime indépassable.
Julian Beck, anarchiste de longue date, non violent proclamé, fût naturellement concerné par les évènements de Mai à Paris. Lui et Judith étaient à la Sorbonne au début de l’agitation. Il était de la partie lors de complots nocturnes à la fac de lettres d’Avignon, rue Joseph Vernet, occupée par anars, trotskars, cheminots et autres contestataires, assaillie parfois dans un pur style médiéval, avec échelles et grappins. Pendant ces interminables nuits de veille, quelques coups de revolver perdus ponctuèrent la bande son.
Pour la première d’Antigone en juillet, le théâtre du “Chêne noir” ayant été soi-disant censuré pour sa “paillasse”, ses acteurs et amis sont assis en tailleur au fond du cloître des Carmes avec un sparadrap bleu-blanc-rouge sur la bouche, comme certaines photos en témoignent. Comme souvent, je trouvai que les répétitions étaient plus achevées que le spectacle final. J’ai toujours aimé les éclats de pierre et la poussière dans l’atelier du sculpteur, les pigments et la tension du cadre dans celui du peintre, le chaos, la nonchalance, les énervements et les litanies répétitives de l’ébauche théâtrale.
Je fus un peu frustré de ne pouvoir saisir simultanément sur le champ la totalité et le grain de ces émotions. Les apparences de jeu improvisé sont trompeuses: cette troupe de beatniks sans fard et sans maques proposait en fait une démonstration qui supposait la connaissance de prolégomènes que je découvrirai après coup.
Après de longues après-midi de soleil et d’ombre, Paradise Now fut créé au cloître dans un joyeux bordel. Le public était constitué, on ne s’en souvient plus, d’un improbable mélange d’Avignonnais ordinaires d’un certain âge se bouchant parfois les yeux, d’une jeunesse cosmopolite fraîchement estampillée rebelle, d’anarcho-syndicalistes sortis de l’anonymat, de cégétistes bravant les consignes centralistes et de journalistes de tout poil. Pour le spectacle, exercices préparatoires, bouquets d’expression étaient embarqués avec la structure du récit, sans architecture dominante, avec une connotation de mouvement perpétuel. Ca bougeait autant sur les gradins que sur scène. Le Living cherchait visiblement à transgresser cette frontière, mais à ce moment précis de l’histoire, le spectateur également en gestation avait la fièvre, et la confrontation, au delà de l’agitation thermique, ne produisit pas de situation singulière. Les slogans du mois de Mai avaient mis la barre plus haut, mais malgré tout nous restions farouchement absorbés par cette forme de théâtre, cette liberté nouvelle donnée aux corps, la rage froide de l’expression(1). Il fallait vraiment faire un effort pour prendre une photo et s’absenter un instant derrière la caméra. Dehors, pression forte et ambiance tendue. De petits groupes d’extrême droite, la mairie fermant les yeux, venaient faire le coup de poing et tondre les “hippies” solitaires.
Malgré cela, une question fondamentale devint obsédante: jouer dedans ou dehors, sortir, comme prévu par l’action 8 à la fin du spectacle. On se souvient de la troupe secouant de l’intérieur les grilles fermées, Beck en tête, suppliant la foule de “libérer le théâtre”. Le théâtre dans la rue pour initier la contagion du changement? On venait d’expérimenter cela deux mois auparavant. Là, nous étions plus dubitatifs, et nous ressentions les limites du “peace and love” avec les grelots tibétains et la pantomime pour amorcer “here and now” une stratégie de guérilla, fût-elle poïélitique !
Par la suite et après quelques épisodes, Beck voulût jouer Paradise Now entièrement gratis hors les murs. Vilar, dans le petit bureau attenant au cloître, livide, au bord de l’arrêt cardiaque, ne cédait rien. Paul Puaux mordait sa pipe. JJ Lebel faisait le malin en traduisant à sa manière les intentions cachées. Le Maire socialo censura Paradise pour d’obscures raisons contractuelles, mais voulait bien éventuellement d’Antigone à la place. Le texte de la pièce circonscrit par les murs inquiétait moins que les clochettes et l’encens livrés à la rue…
Beck, alors, prit le sifflet et clôtura l’épopée.
Ernest PignonErnest réalisa ipso facto une très belle sérigraphie avec le portrait de Beck et la déclaration ultime en 11 points qu’il fit au Verger d’Urbain V. Il reste quelques photos de ce collage.
Au Théâtre des Carmes, Benedetto donnait “Zone Rouge, feux interdits”(4), en soirée et ici-et-maintenant-Assemblée Générale-permanente toute la journée. Georges Lapassade, sociologue et agitateur né, y venait régulièrement, colportant les dernières nouvelles inflammables en provenance du Verger d’Urbain V. C’était Tweeter avant la lettre. En forme d’apothéose il finit par faire entrer la criaillerie des pintades de Jean-Marie dans la cour d’honneur pendant “ Jaguar”, le film de J.Rouch et l’ethnologue n’en fût pas plus contrarié que cela… La légende prétend que les techniciens CGT de la cour d’honneur les firent rôtir et s’en régalèrent.
La France, après les élections de juillet, avec le coup de la majorité silencieuse, était redevenue grassement réactionnaire. Ceux du front populaire de 1936 on du ressentir cet abattement quand cette même majorité se coucha devant le Maréchal et l’envahisseur. Après le bannissement de la troupe par les Édiles municipaux, Raoul Collombe, conseiller municipal d’extrême droite, organisa le ballet de la réconciliation aux allées de l’Oulle, avec le triste consentement de Maurice Béjart, gratuit, avec un aïoli en prime. La Collaboration n’a pas d’odeur, “The show must go on”.
Quelques jours auparavant, j’avais suivi le Living à la Sainte Beaume pour la dernière représentation de Paradise Now , à ciel ouvert. On s’était entassés dans la Fiat 500 des potes italiens de Spolète pour atteindre Chateauvallon. Le Bread & Pupett était présent, avec quelques jeunes compagnies de théâtre nomade, le “théâtre de l’acte” Toulousain…
Très belle nuit, loin des tumultes Avignonnais et seul spectacle du Living que j’ai vu finalement en situation paisible, sur un socle de vieille pierre consacrée par le temps, où se posaient ces anatomies dans un décor prolongeant la statuaire Grecque…
Je commençais à faire partie de la famille, et je fus incorporé de facto avec mon appareil à la performance du tas de corps et de caresses,“the Rite of Universal Intercourse,” d’où ces photos si proches, mais un peu bougées…
On raconte que ce fut la seule performance qui frisa les moustaches du paradis. L’inconscient optique peut-être! La nuit en Provence est parfois si transparente qu’on sent les étoiles à portée de la main.
Puis encore à Genève, le théâtre de Carouge, boîte fermée, public pondéré, l’asphalte tout autour…
Gianfranco me lègue sa vieille motocyclette Guzzi de deux cent kg, parce qu’ils ont décidé de revenir à N.Y. pour les uns ou de partir en Inde pour les autres.
Nos chemins ne se croiseront plus.
Le Living Théâtre s’est atomisé en 70 je crois, comme l’internationale Situationniste en 72.
J’ai entendu parler de leur passage au Brésil dans les favelas, jouant à même le sol, au plus près de la terre poussière…
Beck a publié “chants de la révolution 36-89”, et judith Malina, plus tard, “The enormous despair”. Au Panthéon rêvé du théâtre, Eschyle, Shakespeare, T.Kantor, J.Grotowski, Bob Wilson, A.Benedetto, P.Bausch, S.Beckett, le Living Théâtre de Julian Beck…
“Le veilleur de nuit tambourine, Marina tricote son bas”, j’allais oublier Tchekhov….
Mais c’est une autre histoire…
Il y a quelques années, André Benedetto avait organisé une soirée en présence de Melly Puaux pour évoquer le Festival de 1968. Elle avait la rancune tenace 40 ans plus tard. Pour A.B., qui n’avait guère changé d’avis, la question se résumait ainsi: dans les périodes de grève ou d’insurrection, quel intérêt le théâtre “révolutionnaire” qui s’écrit dans l’urgence du présent aurait-il à se museler lui-même?
Avec le recul, il me semble que ce qui s’est joué ici en 1968, avec cette esquisse de révolution très théâtrale, c’est une pièce de Pirandello avec des monologues de sourds écrits par S.Beckett, ou la fin du théâtre au sens de la fin de l’Histoire de Hegel.
Qui annonce le postmoderne, c’est à dire en partie le recyclage du passé dans la consommation du spectacle de la consommation.
Les Cassandre que nous étions alors annonçaient un monde-spectacle-marchandise si dissuasif qu’il en devenait improbable. Nous étions légers et bavards, la menace à perte de vue. Du reste, nous nous contentions de peu.
J’avais tracé à la fin sur un mur de caravansérail ce codicille, « L’imagination n’a pas pris le pouvoir, mais on est contents quand même » . Benedetto en avait fait la couverture de son recueil de poèmes « les poubelles du vent » . Il a disparu de la réédition posthume, pas assez “chic” sans doute…Cette formule est idiote de toute façon. L’imagination, c’est le pouvoir, le pouvoir de s’en affranchir. Le caravansérail était une magnifique auberge espagnole inventée par Jean-Marie Lamblard.
Le peu est le présent, curseur ascétique immobile sur l’échelle des temps.
Et puis finalement non,
tout cela est arrivé pour de vrai je crois.
Le “paradis maintenant” est une injonction ambiguë. A la référence biblique, la promesse du paradis, s’adjoint l’oxymore du “maintenant”. Pour l’atteindre, il faudrait donc mourir, ce mourir qui efface tout présent! Si on déplie la métaphore de l’apocalypse, le Living jouerait en 2017 “Hell forever “, la peste ou “ radioactive rain before the apocalypsis” ou pire encore: le paradis instantané après l’acte terroriste suicidaire, qui est une concentration insoluble d’enfer réel et de paradis virtuel.
Dans ses “Chants pour la révolution”, Beck livre un credo qui nous parait maintenant un peu désuet et daté dans le ton, mais toujours plus actuel dans le contexte écologique. Le meilleur de l’homme reste possible, sous condition de révolution libertaire…
Cet homme nouveau, par contre, il n’y a plus personne pour y croire après le désastre Stalinien. C’est un des thèmes du « Frankenstein », les victimes deviennent les bourreaux, et c’est sans fin. Le Living fut tracassé par l’impasse noire de leur propre créature théâtrale, ce qui les conduisit, à la demande de quelques membres de la troupe, Jenny Hecht en particulier, à la création de Paradise Now. Mais l’illusion paradisiaque et les menaces d’apocalypse sont des slogans fondamentaux du crédit bancaire, la carotte et le fouet les plus achevés conduisant à la servitude volontaire. La case prison change de place et reste.
Dans le poème de Beck, la mort rôde, voilée.
Chant 88 :
“… keep inventing further actions as long as necessary
how long is that
until we are out of the range of death
how long is that
until we are out of the reign of death.”
Le théâtre dit « vivant » retrouvera ce lieu privilégié où la mort connue et reconnue est une présence préalable indispensable à tout sentiment joyeux d’exister (2), dans le délire des bals musette(3).
“how long is that”
La communauté – nomade / exilée / sans papier / rom / apatride / cosmopolite / libre / errante / sans port d’attache – du Living (celle du Bread & Pupett de Peter Schumann dans une autre mesure également) fût une comète chevelue sans devenir immobilier. Elle résonne pourtant encore comme une communauté, la communauté du poème, du laboratoire, la « communauté inavouable » de ceux qui n’ont pas de communauté.
En 1968, avec l’Antigone de Sophocle/Brecht elle incarnait officiellement la tragédie au festival d’Avignon, et sans le savoir, sa propre tragédie, la fin d’une époque. Le champ de ruines et de moribonds dépouillés, ce tableau souvent incarné par le Living, ces hommes dénudés où l’os de l’âme affleure, tout cela sera désormais recouvert d’un linceul de paillettes, d’hémoglobine, d’éblouissements et de sucreries addictives. La fascination pour et par la marchandise culturelle.
Épilogues:
L’année suivante, en plein festival, après la fin des représentations, l’américain Ulysse Armstrong posait un pied d’Achille à la télévision et semble-t-il sur la lune également.
Jenny Hecht s’exila sur cette lune vague le 25 mars 1971, elle avait 27 ans. Tout à la fin de sa vie, Julian Beck alla fleurir à Berne, avec Judith, la tombe de Michel Bakounine au cimetière Bremgarten, bloc 9201, tombe 68. L’œil toujours malicieux, avec la même flamme, Judith Malina proposera invariablement jusqu’à sa disparition en 2015 le même remède:
« The beautiful non-violent anarchist revolution ».
Pour le plaisir, le nom des acteurs et actrices du Living théâtre en 1968:
Jim Anderson, Pamela Badyk, Cal Barber, Julian Beck, Carol Berger, Mel Clay, Rufus Collins, Pierre Devis, Hans Schanno « Echnaton », Carl Einhorn, Gene Gordon, Roy Harris, Jenny Hecht, Frank Hoogeboom, Henry Howard, Steve Ben Israel, Sandy Linden, Birgit Knabe, Judith Malina, Michele Mareck, Mary Mary, Gianfranco Mantegna, Gunter Pannewitz, Dorothy Shari, William Shari, Luke Theodore, Steve Thompson, Jim Tiroff, Diana Van Tosh, Petra Vogt, Souzka Zeller.
JMP 29/9/2012-2017
note (1):
“La rage froide de l’expression”…. Francis Ponge, Proêmes
https://www.babelio.com/livres/Ponge-La-rage-de-lexpression/39522
Note (2):
“Pratique de la joie devant la mort”, G.Bataille
https://fr.scribd.com/document/222172473/La-Pratique-de-La-Joie-Devant-La-Mort-1939#
note (3):
“Pour en finir avec le jugement de Dieu”, Antonin Artaud
note (4):
“Zone Rouge, feux interdits” , pièce prémonitoire d’A.Benedetto créée en 67
Album photos
texte publié in « Avignon 1968 et le Living Théâtre »
Le Théâtre des Carmes
Cinquante ans après « Statues » en juillet 1966
En 1966, la Nouvelle Compagnie d’Avignon créait au Théâtre des Carmes pendant le festival, Statues, une pièce d’André Benedetto.
Le TNP avait donné les Troyennes à la cour d’honneur, adaptation de Sartre, avec E.Hirt et Judith Magre. Puis Béjart entra en danse dans le lieu. Grands souvenirs.
Venus de Rodez en mobylette, nous campions à la Barthelasse et avec Brigitte on caressait la sauvagerie du Rhône jusqu’au petit matin.
Le festival occupait seulement la cour d’honneur et le parvis du petit Palais comme scènes, le Verger pour discuter, et la place de l’horloge pour continuer la palabre toute la nuit.
René Duran avait repéré une toute petite affiche imprimée au pochoir et collée à intervalles réguliers sur le garde corps du pont Daladier. Dans une boulangerie du quartier des Carmes, j’avais remarqué la sculpture baroque de Georges Beaumont qui invitait au spectacle « Statues ». Bref, on a été voir. Ils faisaient des tarifs étudiants et chômeurs. Une porte d’entrée vitrée en bois verni à coté d’un garage Simca. Une petite caissière rieuse sortant tout droit d’un film de J.Eustache nous fait les tickets à la main. Un couloir, puis un espace cubique qui contient la scène et les spectateurs. Ce jour là, on était six en tout, assis sur des sièges rustiques familiers aux cinéphiles. Les échelles étaient en bois, le grill technique, espacé nombre d’or, également. Le décor était une sculpture d’objets usés. La main de l’ouvrier était subliminalement partout.
Le noir. Une voix dans le noir, qui déjà le tient à distance. Miouzic… et c’est la lumière qui vient. A l’intérieur du cube, deux cubes, avec les acteurs plantés dessus. Très proches de nous, à portée de main, sans protection chorégraphique. Le texte comme fumerolles éclairées de l’intérieur au dessus du magma. Je crois entendre quelque malice entre les cubes et l’Hécube des Troyennes, et dans cet espace clos il y a l’univers entier, tout l’espace des questions, intravagantes, extravagantes. Mais c’est aussi un tableau achevé de peintre, une variation de gris et de couleurs délavées, un retable païen. Une banderole de papier se déroule « libérez le vietnam », c’est pour le maintenant, avec en sous titre le tempo, c’est pour la musique. Le géant Atlas passe chargé de son monde en ruine, c’est pour le mythe. L’actrice a des allures de cantatrice prophétesse grecque. Lui, par moments, dans son costume empesé, pourrait être ce Godot enfin arrivé de nulle part. Entre les deux, la petite fille installe le rectangle bleu saturé d’une piscine voulue.
On à découvert ce jour là le théâtre « Totol », parce que ce théâtre contenait l’autre. Il avait l’inspiration, l’âme et les armes dont nous avions alors besoin. Puis on a discuté un peu avec ce gitan lanceur de couteaux et cette Compagnie si accueillante. On en a parlé aux potes cinéastes, on est revenus. Dans l’hiver qui suivit, André nous envoya à Rodez une longue lettre tapée en rouge majuscule sur du papier pelure, histoire de dire, on pourrait faire équipée. C’est ce qu’on à fait, finalement.
Maintenant, cinquante ans plus tard, le 7 juillet 2016 au matin, on va poser la plaque du créateur du OFF. Étrange distorsion. C’est le théâtre IN qui a été ré-inventé ici.
jmp/06/2016
Statues éternelles, plaquées au mur
Le 7 juillet 2016, la cérémonie réunissait plus de monde et de caméras que de spectateurs lors de la création de la pièce en 1996. Bertrand Hurault en maître de cérémonie pour accueillir les édiles locaux, Philippe Caubère, Ariane Mnouchkine, etc. Claude Djian et Charlotte Adrien ont donné quelques extraits de « Statues », variante théâtre de rue, ce qui n’était pas une mince affaire. Là est l’alchimie du théâtre. Un texte dit initialement dans le noir et enfermé dans un cube clos qui se retrouve projeté en plein soleil sur un trottoir, toujours en vie. Jean-Marie Lamblard qualifia cette intervention d’abominable non-sens.
Puis Ariane, les ciseaux à la main, en peu de mots, à demi-voix, a parlé du corps de l’homme, de sa beauté et de sa fureur inoubliables.
D’une main de sage femme elle a coupé le fil de ce qui semblait être un cordon ombilical des limbes et le linceul noir est tombé, laissant apparaître, rivée au mur, la marque d’un commencement révolu.
Et de là on a vu surgir des milliers d’oiseaux rieurs, chacun son cri, emporter à tire d’aile l’âme libérée du poète vers les herbes folles du temps retrouvé.
jmp/07/2016
Jo, Georges Benedetto
J’ai en conserve, une bande-son du 4 mai 1978 de Géronimo (dernière représentation) que j’écoute toujours avec un rare plaisir, un petit montage ( pièce intégrale, 1h40) revisité avec 10 photos qui me restaient et d’autres exhumées par Christian Segurens, plus un prologue ad-hoc d’André écrit plus tard en 1998,
Et aussi le texte en occitan « San Jorgi Roc », écrit et joué par André après la mort de Jo, en 1997-1998, pour lequel j’ai aussi fait un montage revisité avec des photos pêle-mêle de Jo dans ses 23 ou 24 participations à des pièces de la Compagnie, plus le prologue écrit pour l’occasion en 1998 et dans lequel André précise les contours de sa relation à la langue Occitane,
et à la demande de Pascale qui collectait des textes sur Jo, j’ai revisité quelques situations…
Dans les années 68, Jo était cheminot et communiste convaincu. On le croise un petit matin d’hiver avec ses potes dans un bar près des Carmes, lui avec ses colleurs et colleuses d’affiches, et nous, les situ-gauchistes (c.à.d. Claude G. et moi-même), au bout d’une nuit de dérive, à détourner et calciner d’autres affiches…C’était notre première rencontre en dehors du théâtre. Il avait à cette heure embuée encore de l’énergie pour essayer de nous convertir à la ligne des masses en regrettant la main de fer du camarade Joseph Djougachvili… Cette outrance pagnolo-stalinienne m’intriguait sans convaincre, mais je la trouvais plus séduisante que la litanie des contritions penaudes alors en vogue.
A bout de convictions, un argument indépassable lui apparut. Il était et serait toujours prêt, me dit-il, à payer de son corps vigoureux et de ses « sentiments » pour obtenir d’une femme qu’elle prît, exaucée, la carte du Parti et finisse par adhérer…(la parole originale était bien plus verte!)
Le jour se levait. Ses copines militantes avaient du rose aux joues et des étoiles dans les yeux.
Il avait la mauvaise foi grandiose d’un toréador, mais sa présence était naturellement protectrice. Il avait une moto Ducati desmo 350 qui slalomait dans les virages comme sur un rail disait-il. On a beaucoup rigolé ensemble par la suite.
En 1998, après que Jo eût fini de se consumer, j’ai proposé à André d’aller enregistrer « San Jorgi Roc » dans les bois. On a pris la petite Fiat bleu turquoise, on a cherché et trouvé, au dessus de Tavel, une lisière devant quelques pins oubliés séparés par une bande de terre retournée, parsemée d’éclats de pierre. On s’est tanqués là. J’avais bricolé une perche stéréo qui ressemblait aux cornes en bois qu’on utilise dans les écoles taurines pour simuler le toro. Pas un souffle de vent, pas un oiseau, nul témoin, un silence de page blanche. André à débité son poème sans interruption pendant quarante minutes les pieds dans la caillasse, et je n’ai pas bougé d’un pouce non plus, les bras tendus. Étrange face à face.
La cérémonie terminée, de retour au théâtre, aucune parole pas le moindre commentaire durant le trajet. On eût dit que nous venions de commettre un acte fatal épouvantable.
La situation s’est éclaircie depuis. Mon projet d’aller gueuler le poème dans la forêt n’était pas innocent, cela avait à voir avec la lycanthropie et les hurlements de loup dont André m’avait instruit quelquefois. Dans le texte en Occitan, utilisé comme proto-langue matricielle, il invoque et appelle le frère sans cesse pour qu’il parle encore de vive voix, « oun te sies..oun te sies », et comme dans la pièce Xerxès, mais c’est du théâtre, l’invocation de Darius aboutit à le ressusciter et il parle. Là, nous étions sortis du théâtre, de ses codes, et nous jouions avec des sortilèges qui sont plutôt le lot des mages. Jo s’est sans doute incarné ici d’une manière ou d’une autre, au delà de toute attente, et la garrigue de terre rouge dans laquelle nous étions plantés n’y est pas étrangère. Pour André, il ne pouvait y avoir de témoin à ces extravagances et dès lors, entre nous, un pacte de silence enveloppa tranquillement la situation.
Quelques jours plus tard, il ajouta à ma demande un prologue pour le C.D. Géronimo / San Jorgi Roc, avec la même économie de moyens et de mots.
Parfois je revois aussi cette scène comme une variante de l’Angélus de Millet, entre mecs et sans la brouette, mais avec l’interprétation analytique qu’en fait Salvador Dali dans un bouquin rigolo qu’on trouve encore en Espagne.
Vingt ans après, le pacte s’est évaporé, et cette évocation est peut-être le dernier stratagème pour les entendre encore, le grand frère et le petit frère, inouïs.
JMP / 2017
Pèlerinage de nuit à l’olivier, Tavel 2013
Décor posé: Une toile peinte, la ronde de nuit de Rembrandt
Là, nous passons devant ce qui fût la maison de Jean-Marie Lamblard, qui a été la cheville ouvrière de la Compagnie des Carmes à ses débuts et qui vivait ici avec son frère et ses parents.
Cortège sombre dans la nuit nocturne. Suite funèbre ou messe noire? Nous sommes le dimanche 27 octobre 2013 à Tavel. Dans un temps qui pour moi est un temps chimérique dans lequel je suis une ombre projetée dans un espace immatériel qui ne m’appartient plus. Francès nous a affublés , Guy L. et moi-même, d’un flambeau minuscule pour éclairer la route.
Nous longeons les poulaillers. Derrière il y avait le labo photo de Jean-Marie et un millier de pintades en semi liberté. J’entends sans magnétophone la voix de son frère Yves disant son poème « le soleil et la pluie», j’entends cette voix qui était traversée d’éternité et croisée avec le son de la corde bourdon d’une vielle à roue, une voix monodique qui psalmodie un cri doux et saturé d’oiseau de nuit.
Claude G. n’est pas venu participer à cette étrange cérémonie. Je suis seul à connaitre cela. Avec le flambeau, je pense que le sort me désigne comme le dernier gardien des enfers, de la crypte. Nous passons. La voix d’Yves continue le poème. C’est un poème d’amour inouï. Il était inspiré d’un autre, comme un repeint. Mais il était cousu d’un fil invisible. Chaque lettre tracée avec des trous d’épingle dans un papier de cahier à spirale, surpiqué par le temps passé à faire cicatrice entre les lignes. Il est un temps sans tempo et sans bord, il est avant nous et longtemps après toujours…
Nous nous dirigeons vers un olivier planté en hommage au Poète Benedetto dans ce qui était un terrain vague à l’époque. Là où nous faisions les fêtes et les méchouis. Là où des italiens de Spolète avaient joué en 1968 un Œdipe peut-être avec les colonnes du fond, là où commençaient herbes folles et caillasse.
Plus personne pour attester de cela, mais qui parle en dernier ?
La jeune femme se cale sous l’olivier son texte à la main, un poème d’André sur les arbres, un poème modeste.
G. de l’autre coté, un peu en recul, fait la symétrie. En Géorgie j’ai vu ces sortes de cariatides baroques portant flambeau et soutenant la voûte à l’entrée des théâtres. Maintenant, nous soutenons de justesse l’insoutenable nuit.
Je me suis planté là derrière elle à coté de l’arbre pour éclairer sa feuille avec mon allumette.
C’est une jeune actrice étonnante de verdeur dans la voix et d’une épure totale dans les artifices. Elle est des Cévennes. Elle ne sait pas qu’elle sait. Elle est à l’aube de sa vie. Un coup elle montre l’olivier, un coup elle désigne la nuit. C’est tout pour la chorégraphie.
Je titube dans l’immobilité, avec cette flamme qui vacille.
Elle va jusqu’au bout de son chemin sans faiblir. Elle a une pointe d’accent dont elle joue sensiblement. Les mots sont en suspens dans l’air, sans corps, tracés. Il y a des odeurs de terre cramée par le soleil et de garrigue dans sa voix. Elle pioche elle lutte avec ce texte. Elle sait qu’il faut cela pour tirer du vin de ces contrées arides, que ce n’est jamais gagné. Elle sait cela depuis toujours. Personne ne le lui a appris. Elle sait cela.
Le guetteur ferme un œil, je ne suis pas seul à savoir, finalement.
Ces emballements oniriques qui nous traversaient alors ici même et que le noir enveloppe à tout jamais, invisibles aux yeux de tous, dont nous marquons la clôture en cet instant, la nuit nocturne, la nuit des paroles, l’envers du mourir, les lèvres suspendues à la nuit, prophétie pour des lucioles.
Mais cette actrice finalement, elle est rieuse, elle parle aux ombres mais elle s’en fout, elle a la vie devant elle, pleine de promesses.
Elle pourrait s’être extirpée des sabbats nocturnes qui se tenaient là sous ses pieds il y a longtemps et y retourner danser après, incognito,
mais non, elle est détachée de cette tâche.
Elle dit à peine, mais c’est entre les mots qu’elle lit, c’est entre les dents du verbe, je vous délie également de tout.
Tout flottement égal.
Les arbres restent et les oiseaux volent de branche en branche, tant que nous parlons des fous aux pierres, aux farfadets.
Foin des cataplasmes mais remède quand il n’y a plus de remède, le conte, le théâtre des lieux, le théâtre hantique, les paroles de vent, la veille, les simagrées.
Tourmenter et puis soigner et puis s’éloigner,
finalement.
Le gardien stoïque du temple de l’oubli éteint son sémaphore.
« le veilleur de nuit tambourine
Nous nous reposerons ».
La nuit est claire,
Finalement.
Et c’est enfin la fin d’un épisode daté approximativement,
difficilement cerné,
inachevable
( épisode tel quel ).
JMP /28 /10/2013
Bernard Lubat solo, carte et territoires, au Théâtre des Carmes, avril 2023
Deux espaces cubiques. Au fond, le mur décrépi du Théâtre des Carmes surplombe la scène et son manteau. Lieu vernaculaire, celui de la langue du poète André Benedetto. A l’origine cet espace était fermé aux yeux des spectateurs par un autre mur qui faisait office d’écran de cinéma. Les pièces se jouaient dans le premier cube, à même le ciment du sol, acteurs et spectateurs entremêlés. Dans le second cube, invisible, au milieu d’un fourbi de décors et costumes se trouvait un vieux piano à queue déglingué avec lequel on faisait de la musique concrète de nuit en grattant les cordes de basse. Maintenant, après que l’écran eut été crevé, on a un vrai théâtre à l’italienne, avec une salle emplie de fauteuils rouges et une scène en chêne massif. Au fond, le mur décrépi reste gardien du temps.
15 avril 2023, Bernard Lubat a posé en bord de scène les objets du délit, ses iles, équitables, une batterie à gauche, un micro sur pied, une petite table couverte d’instruments en plastique, un accordéon avachi sur une chaise pliante, un autre micro, une plaque de tôle réfléchissante couverte d’écritures blanches, à droite. Au centre du circuit, un peu en retrait, un piano à queue Steinway noir brillant surmonté de trois poêles à frire. Quelques lampes de chevet éclairent le tout.
L’acteur-auteur entre avec ce léger balancement qui deviendra swing quand il atteindra le bout de ses doigts. Pour l’heure ce sont les mots, un long préliminaire de mots, dans la géhenne des mots, puis le liminaire, puis le prologue et tout ce qui s’en suit. Dans une langue qu’il qualifie de « poiëlitique », ou le lapsus est générateur de sens, Lubat détache les éclairs d’une conscience insomniaque, assidument, avec une élocution claire, dans un tempo que rien ne semble pouvoir interrompre. Réfutation de la virtuosité savante des chiens de cirque, des palmes, des flagorneries et des exploitations marchandes. Toujours dans un espace lié entre voir et dire, entre marteau et enclume. Le glissements des sens, Edouard Glissant sans glissando, Deleuze, Félix, Guattari, les signifiants vides …
Au bout de quarante minutes la suite aphoristique à fait son chemin, toujours sans la moindre mélodie, mais suivant un rythme de marcheur pour acte épique.
Traversée de la scène, pose de l’accordéon à terre, leçon de chant. Du vagissement au chant, du borborygme à la vocalise, le commencement de la mélopée, le cazou au bec.
Finalement, c’est un long prélude amoureux, traversé de contre-temps, déjoué, une attente érotique. Une lente approche. La lecture des notes avant de jouer des notes. L’extase, ça se mérite, l’appétit venant avec un peu d’exercice vocal.
A pas mesurés, direction piano.
Quatre séquences de cordes frappées.
Lubat est un sismographe branché sur son magma intérieur avec des antennes en surface, genre état d’urgence, les neurones directement connectés aux mains. La pudeur est un manteau froid qui génère des pressions éruptives.
Quand on peut entendre sa propre pensée entrer en résonance, dépouillée de ses itérations contenues – des fulgurances – emballements et replis – explosion combinatoire du sens – tachycardie de l’âme – syncopes de l’oubli – alors l’équation se réduit à sa plus simple expression – devient irréductible – d’où ce sentiment de plénitude – mais que tout aveu ou consécration vont disloquer. Orphée, ne te retourne pas!
Puis l’accordéon, piano à bretelles, vient s’harnacher au corps du récit.
L’objet chromatique saisi d’une main, agonisant de l’autre jusqu’au sol, il produit un gémissement, un accord soutenu, et de là surgit alors le cri. Un infracassable hurlement de bête du Vacarès, le long mugissement d’un taureau minotaure.
Quand Bernard se déplace physiquement ou quand il brame à l’accordéon, on pourrait voir surgir Orson Welles dans Falstaff, une Jeanne Moreau coquine lui tirant la barbe.
Dans le « danseur des solitudes », Georges Didi-Huberman qualifie le danseur Israel Galvan de « danseur des arrêts ». Il le compare, avec l’aide de Bergamin, aux toreros Belmonte et Joselito sur des figures syntaxiques communes. Le « remate » (rematar), faire de l’arrêt une figure, et le « temple » (templar), l’art du ralentissement et de l’accélération en même temps.
Ceci ne parlera qu’aux aficionados, mais Bernard Lubat est à la fois taureau et torero. Il se torée lui-même, avec ces mêmes figures. Peut-être est-il plus danseur qu’il n’y parait. C’était un sujet de conversation quand nous marchions lentement en plein cagnard un été de 2006, du Théâtre des Carmes à l’hôtel de Sade où il jouait avec André Benedetto l’implosion de Clément V. Confronté au ravissement, le ravisement comme figure de style est-éthique, remède irrémédiable à la mort.
Je convoque l’autoportrait de Rembrandt à la ronde de nuit, juste pour la forme. C’est bien un autoportrait de l’acteur dessinant sa carte et son territoire au milieu des humains, auquel nous assistons. Les silences et les pauses en sont les frontières tracées au rasoir. Les balles de ping-pong qui tintinnabulent sur les cordes du Steinway, les canettes de soda froissées qui swinguent, une moulinette en plastique, c’est encore du Lubat et dans le silence d’avant les mots, la glossolalie fait ses arpèges.
Le coup de batterie, un tour de force. Deux grosses baguettes de clown pour dire, attention, voilà un numéro de cirque imposé, magistral, poum, entre parenthèses, tchac.
Et pour commencer de finir, deux exercices encore assis face au clavier. Le premier avec fléchettes ping sur poêle à frire, et le dernier en chanson révolue, « avec le temps », léo Ferré … « avec le temps, va, tout s’en va … et l’on se sent tout seul peut-être, mais peinard… »
A cet instant, une esquisse de fin s’est faufilée,
le miroir, intact, faisant signe en dernier, il faudra bien finir de commencer.
Dans la cuisine sonore de Bernard Lubat, on a vu souvent enclumes, tôles suspendues, ailes de voitures et pare-chocs qui vont crisser ou être frappés de stupeurs arithmétiques.
Mais ici ce miroir n’en est pas un, c’est une plaque de réflexion inoxydable, couverte d’écritures blanches, à travers lesquelles filtre dans le vide des mots, le visage de l’acteur-auteur, page blanchie au pinceau, palimpseste en négatif, interminable repeint. Il est habité par quelque diable venant réclamer son dû au docteur Faust. Mais qui de l’acteur ou de l’auteur est le malin ? Dans ce théâtre la question fut posée en son temps.
L’acteur se ravise, se confronte à l’objet spéculaire, le saisit à bras le corps pour lui faire rendre gorge, le secoue comme un prunier, le sature de réponses sans question, disparait dans son ombre, questionne encore, détache l’œil de l’auteur de son orbite et fait parler la mort insatiable.
A la fin de tout, la carte est dessinée. Une bibliothèque de Babel avec des pays qui se touchent se chevauchent et se brouillent, l’alphabet des paroles et des mots-dits, l’infinie variation des 27 signes de l’écriture, le son des coups de patte, le registre intempérant du clavier bien tempéré, l’idéogramme des corps, le catalogue des regrets et le chant des baleines.
Le territoire, plus vaste, c’est l’Histoire.
Cartographie inachevable d’un testament de conscience avec un gros nez rouge.
La boucle du marathon express aller-retour sans retour est ainsi close. Acte unique, austère, exténué, irréductible, non duplicable, sans suite immédiate envisageable, frangé d’effacement.
Dans ce théâtre j’ai eu quelquefois ce vertige, l’espace d’un récit avec Benedetto, quand l’acteur-auteur se consume au millimètre jusqu’au dernier souffle au cœur. Avec le temps et contre-temps. Ici les murs ont peut-être encore des oreilles en forme de radar pour entendre entre dire et voir.
Bernard, tu as joué tes notes bleues et tes notes de bas de page très exactement sur le clavier de mon œil d’oiseau rétif. Cela m’a fait un bien éternel. Merci.
JMP 22/08/23
« Cela commença sous les rires des enfants, cela finira par eux. Ce poison va rester dans toutes nos veines même quand, la fanfare tournant, nous serons rendu à l’ancienne inharmonie. Ô maintenant, nous si dignes de ces tortures ! rassemblons fervemment cette promesse surhumaine faite à notre corps et à notre âme créés : cette promesse, cette démence ! L’élégance, la science, la violence ! On nous a promis d’enterrer dans l’ombre l’arbre du bien et du mal, de déporter les honnêtetés tyranniques, afin que nous amenions notre très pur amour. Cela commença par quelques dégoûts et cela finit, — ne pouvant nous saisir sur-le-champ de cette éternité, — cela finit par une débandade de parfums… »
Arthur Rimbaud – Matinée d’ivresse
images
notes légères éparpillées
sans que ni textes
Arles, décembre 2003
Grande crue centennale du Rhône. Arles entre dans le siècle. L’eau monte lentement bien au delà des plus anciens souvenirs. J’ai construit un barrage de bric et de broc face à cette insistance. Ca fuit de partout. Il faut accepter l’imperfection. J’en construis un autre dans le couloir, et du petit bassin créé je rejette l’eau avec une pompe de cale improvisée, comme dans les rafiots percés. Ça va tenir le temps qu’il faut. La puissance et le bruit du fleuve sont fascinants. Les crues du Nil ont nourri l’Egypte dit-on.
Le troisième jour, une mouette se pose sur la martellière, un rameau d’olivier dans le bec.
L’eau est obsédée par l’interstice. Elle finit par s’inviter à l’intérieur des pages et pénètre particulièrement bien les livres posés au sol. Le limon est une colle étonnante. D’une bibliothèque il fait un bloc de pierre aussi sec.
Pour éviter la pétrification des bouquins, il faut les doucher délicatement, puis les faire sécher, jupons en l’air, tels des accordéons dépliés.
Gondolés mais ouverts, on les butine, on les relit d’un doigt. C’est déroutant, un livre exhibitionniste, avec ses recti-lignes posées sur des surfaces courbes ou chiffonnées, et qu’on ne peut plus refermer.
L’idéogramme des corps, la force vide des visages, le retour des cigales,
mémoires insubmersibles
5/7/2014/ place Paul Doumer
le moment voulu est un moment donné
« il le voulait depuis toujours »
le non-vouloir l’a mué en don
survenant hors de l’attente
à l’occasion
dans la tessiture de tout ce qui survient
ne vivant vraiment que de nuits
au bord de l’écriture
tu as souvent confondu cela avec la musique noire du « Duende »
l’attente n’attend plus
en buvant un thé à la menthe.
jmp/2014
Vallée d’Ossau / 2003
Non pas simuler les nuages, mais un désordre
d’effacements.
d’où vient le flottement.
après une nuit
dans la montagne, arrimé à un rocher prométhéen, après
avoir veillé sur le sommeil des hommes, bordé le gros édredon de
coton, on se trouve soudain envahi par une odeur de soufre dans
l’océan de brume lente et que l’on perd tout repère dans la
solitude du ciel.
face au ciel,
face à la vallée,
le
jour à venir.
Au fond de la vallée in extrémis, de petits jets de vapeur s’empêtrant dans mes ficelles éclectriques, la question n’était pas loin.
Suspens dans l’air, immobile à nouveau,
entre deux eaux.
Un archange noir a parlé en langue étrangère
des «Rheinfall», de l’éternel retour, des larmes du plaisir.
Filmé l’envol d’un jeune vautour au port de Béon.
Il a embrassé le paysage paisible avant de s’y précipiter, étranger au monde d’avant, déplié.
Architecture de ses clavicules d’air, à elle.
Camargue / 2004
En Camargue, les couleurs saturées sont fixées dans la mémoire de l’hiver.
Durant l’été les cigales et les hommes ont la fièvre surexposée.
Cette nuit, finalement, j’ai dormi au-delà de la suite des jours.
Le cœur des vieux indiens Hopis bat à un rythme de palourde, et entre chaque sentence, on a le temps d’aller faire un tour, jouer, boire un coup et revenir à la maison, à la belle heure.
On connait les histoires de rats des villes
et de rats des champs,
la sociologie des hyènes et du chacal,
l’ errances des loups esseulés,
l’anoxie du sang païen.
Les fausses pistes, question sans objet!
Entre l’irrésistible désir de percer les mystères en inventant des stratagèmes qui les dévoileront, et le plaisir béat d’entretenir, d’arroser et d’engendrer la vie qui nourrit la continuité de l’espèce, toutes les pistes se valent et on a du temps pour se perdre ou se pendre.
Pas d’équilibre entre ces tensions, mais une suite de chutes qui sont le propre de la marche, qui dessine parfois, en arrière de soi,
un chemin.
jmp/07/2004
Duino, 07/2005
Rodin « le marcheur » revisité.
«… Cette figure est significative encore à un autre égard. Elle indique dans l’œuvre de Rodin la naissance du geste. Ce geste qui grandit et atteignit peu à peu une telle grandeur et une telle puissance, ici jaillissait comme une source qui ruisselait doucement le long de ce corps. Travaillé dans l’obscurité des premiers âges, ce geste paraît tout en grandissant marcher dans l’étendue de cette œuvre, marcher comme à travers tous les millénaires, très au-delà de nous, jusqu’à ceux qui viendront. En hésitant il s’éploie dans les bras levés; et ces bras sont encore Si lourds que l’une de ces mains se repose déjà de nouveau au sommet de la tête. Mais cette main ne dort plus, elle se concentre; tout en haut, à la cime du cerveau, où règne la solitude, elle se prépare au travail, au travail des siècles dont on ne mesure pas la fin. Et dans le pied droit, attend, debout, un premier pas… »
R.M. RILKE prose
éloge de la fatigue
“un homme qui dort “ de Pérec. J’en suis.
Même conclusion chez l’indien Hopi, mais sans retour entre les lignes.
Une araignée dans l’œil de l’ermite, qui ne dort jamais de l’autre, s’allume dans l’intact d’une présence, le feu et l’eau ayant partie liée.
Métabole inachevable, consommée, épuisée,
indicibles amours,
invincible esquisse du jour naissant.
oui inouï
Histoire d’un “ oui “ inouï dans le «Prince de Hombourg» à Avignon, racontée par Michael Meschke. Venu de Suède en stop a vingt ans, il s’est improvisé journaliste et rêve de rencontrer Gérard Philipe. Mais il retiendra surtout ce long “oui” flottant prononcé par Jeanne Moreau à propos du gant dérobé. Dans le velours noir d’une nuit d’été 1951, le songe du Prince somnambule qui prend corps le submerge. Émotion si parfaite, dit-il, qu’il renonce sur-le-champ à toute velléité de devenir acteur, ne pouvant jamais espérer égaler cet instant.
A la suite de quoi, dans le secret réduit de ce ravissement, relié à Kleist peut-être, il consacrera son œuvre au Théâtre de marionnettes.
(dans la traduction de Orthmann / Recoin, la réplique de Nathalie est seulement : ”le mien, celui que j’attendais”. On pourrait entendre dans le “oui” liminaire apposé par l’actrice, une génuflexion qui préfigure le sublime de l’aveu à venir, et qui finalement, l’éternise)
2006/ Arles, 20h, visée ouest
Algèbres verticales traversées par le cri effaré d’un animal crépusculaire, où tout à été dit, peu déchiffré, reste à écrire, encore.
dans ce presque rien qui fait signe,
les grands vents d’ici effarouchent les sens.
la transparence est présente dans ces partitions de musique sacrée,
on attend une note, une pause, un soupir,
l’étirement du temps,
la retenue.
il n’y avait pas âme qui vive dans la Crau des Coussouls ce soir là,
et je tergiversais à travers cet inextricable rideau de chiendent et de galets posés en tas.
Il parait que les satellites viennent recalibrer ici leurs capteurs infra-rouge dans l’immuable.
Cette terre est une Camargue fantasmée, parce que ce n’est pas la Camargue, c’est le Coussoul de Marguerite la bergère.
Et ce rêve a existé ici jadis dans des auberges tapageuses, papilles écarquillées, à toutes faims futiles.
Contrairement à ce que prétend l’adage, manger est suivi d’une certaine somnolence et l’appétit viendrait plutôt avec la faim, l’eau fraîche, et l’amour qui accompagne.
Patience dans l’obscur.
juillet 2012 / Arles
survivre sans fin sans doute
à un baiser fraternel,
sur le front de son ami libraire ivre des livres, devenu désormais étrangement sans voix lui à qui je disais “tu as été vacciné avec une aiguille de phonographe, tu n’arrêtes jamais de parler”,
se tenir compagnie,
attendre qu’il ouvre un œil,
attendre un signe de ses grandes ailes,
attendre qu’il ait fini de boire la dernière goutte de sa cigüe.
Pour finir encore et autres foirades.
Notre commune solitude.
Et reviennent les fantômes brasseurs d’air, les emprises, les froissements d’elles qui rompent le charme des élans fraternels, Dieu sait pourquoi.
Puis préparer un café, allumer la télé, voir le pape chorégraphié par Pina Bausch, étendre le linge, regarder l’heure (cinq heures du matin à peu près ), mais revenons sur nos pas.
Pause / rewind
il y a un bruit qui manque, un faux mouvement sec, une maladresse infiniment précieuse au plus tréfond.
ne pas se pencher ni penser au delà.
Souvent endormi au milieu des ordinateurs en désordre, pinceaux et danseurs derviches, miroir à neurones, je n’écris plus, parle peu et me grise vite.
En orientant la parabole auriculaire qui me reste à peine au-dessus de la ligne d’horizon, j’entends sans cesse un souffle interminable qui n’est pas né du silence, voyage par ricochet et coule de source, étrange et familier.
Un visage interroge l’évidence qui le dévore..
Voici à nouveau la page effacée
des commencements.
Cantilène:
Commence ce jour avec lenteur, raye paresseusement la nuit, congédie, dans l’inconnu, ton rêve. Ouvre un œil à demi-voix, touche ravisseur le sommeil d’un autre corps, ausculte l’érection matinale,
écoute la bruine au dehors,
et vice
versa.
Replay / pause
2005 JMP
Irréversible, c’est à Manosque en 1980…
Avant le feu d’artifice, grande fatigue, le cirque « Alligre », un dompteur de rats qui se confiera plus tard aux chevaux, le trapéziste « Paillette » qui crève littéralement le toit du chapiteau, «Reine» la papesse et Michel Brachet le «diable blanc», frêle funambule gravissant lentement sur son fil la nuit caniculaire. Je lui ai fixé des cascades pyrotechniques aux extrémités du balancier qui mettent illico le feu à la garrigue,
Le maire de la ville, pompier de service, pisse sur les braises,
et finalement les flammes d’herbes sèches plus fortes que tous les artifices et les tours de force..
Au degré zéro de la combustion, la contagion est sans mesure.
En 1982 au musée des Beaux-Arts de Pau, Kinie Araguas échafaude une installation de coquillages éclatés percutant une table en verre,
“la chute d’Icare”.
A quelques pas de là, le «diable blanc» exécute un numéro à vélo, tombe de son fil et meurt.
Avec la pesanteur, même ce qui est fabuleux
inexorablement touche terre.
L’apocalypse de Jean est une allégorie qui annonce égalité entre commencement et fin,
et pour ne pas mourir seul, suicide général !
Entretemps, éclairs et soubresauts !
la littérature est un mouvement de foi.
la littérature est une planche vermoulue de salut au dessus du vide.
la pesanteur terrestre est une composante de l’attirance
des corps les uns pour les autres relativement restreinte.
Relue dans des versions différentes, cette fable folle, imprécatoire, peut s’appliquer aux vallées étroites, aux rituels nocturnes de la transhumance et aux ciels obscurs et rouges.
(Dans la pièce de Benedetto sur les évènements de Gènes, une réplique disqualifie l’apocalypse
en suicide collectif petit bourgeois…)
2020 / mauvaise humeur rien à écrire
Tout art tire son origine d’un défaut exceptionnel.
2021 / frivolités et remords
j’aurais du pouvoir vouloir vouloir, mais Bergson prétend que c’est impossible.
j’aurais du lire Proudhon et jusqu’au bout, quand, avis contraire, la propriété n’est plus le vol.
j’aurais du lire Feuerbach avant les Grundrisse et ne pas me contenter des onze thèses de K.Marx.
j’aurais du lire les “commentaires” avant “la société du spectacle” de G.Debord au lieu de me régaler de son irrévérence et de ses chiasmes insolents.
j’aurais du examiner en détail les controverses avec H.Lefebvre sur la mort de l’art, le romantisme révolutionnaire, la fin du surréalisme et faire soigneusement des fiches.
j’aurais du lire les textes premiers de L’IS en 1957 sur la distanciation chez Brecht, et la critique de R.Barthes également.
j’aurais du lire in-extenso Lukacs et Gabel, fausse conscience, réification, fétichisme et aliénation, pour saisir le jeune Marx et les prémices du spectacle.
j’aurais pu me méfier des emballements incantatoires de M.Duras et de M.Blanchot.
j’aurais du continuer le piano.
j’aurais du revisiter l’ineffable Stefan Lupasco, “Du rêve, de la mathématique et de la mort”.
j’aurais du essayer Benjamin avant Baudrillard mais à tant que faire j’ai opté pour Thomas Bernhardt.
j’aurais du m’intéresser à ce que Marx appelle la « production organique », je m’y serais retrouvé et mieux compris “ne travaillez jamais”,
j’aurais du trouver un passage souterrain entre H.Hesse et Victor Hugo, la forge de Giliatt et le jeu des perles de verre.
j’aurais du voler le baiser que me tendit Jenny Hecht en 1968 un jour de vent.
j’aurais du cesser de m’enivrer dans les ruines circulaires de Borgès et les maelströms de Poe.
j’aurais du assassiner les troupes ennemies, ça m’aurait mis du plomb dans la tête, mais je suis resté léger comme une aile de cigale, selon le vœu de ma mère assurément, elle qui savait déchiffrer les nuages qui passent et les sonates de Beethoven..
J’aurais du prendre la psychanalyse au sérieux avant d’en devenir le sujet, au lieu de me focaliser sur les notes de bas de page de Lacan, là où pointent, entre autres, les “Anamorphoses ou Perspective curieuses”, de Jurgis Baltrušaitis.
J’aurais du toujours tout remettre au lendemain,
ça rend immortel.
J’aurais jamais du oublier d’oublier.
20/1/2021 JMP
Chimères / 2010 / 2021 / Arles
Je suis certain d’un point de vue de l’ombre
J’aime faire de la lumière
Lumière qui se déplace expressément et vite
Si vite qu’on n’y voit pas le temps passer.
Et qui permet de baliser
essentiellement à toute fin,
l’endroit où elle sombre.
J’aime les instants irréversibles et leur poussière d’inconséquence,
juste à temps, in extrémis.
J’admire les amis et camarades qui attisent les braises de leur utopie,
seuls face au Léviathan.
Je glisse sur les ailes du temps, le son d’une allumette à l’âme.
J’ai déjà «tout perdu» cent fois,
de ce tout qui fut jadis,
un «presque rien» parachevé.
Oh! s’éparpiller dans la parole,
mais silencieuse,
hors de l’attente,
hors de toute atteinte,
hors de toute entente.
Je mens / je crois / c’est égal.
2003/2021/JMP
commentaires
envoyer un Mail